Dossier
La collaboration inter-hospitalière
- La collaboration inter-hospitalière : le mouvement est en marche
- Regards croisés entre Etienne Caloz et Mikael de Rham
L’ère des alliances n’est qu’à ses prémices - Collaboration : Fondation de Nant et HRC
La psychiatrie comme partenaire à part entière de l’hôpital - Hôpital de référence et pôle santé
Vers une vraie complémentarité ? - Digitaliser le processus de gestion des mesures limitatives de liberté :
un défi qu’il fallait relever à trois
La collaboration inter-hospitalière :
le mouvement est en marche
Médecin Chef
Service de Chirurgie Vasculaire
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC)


En 2023 a eu lieu le premier symposium inter-hospitalier sous l’égide de la FHV. La planification hospitalière et la nouvelle génération de directeurs·trices à la tête des établissements membres encouragent les partenariats afin d’optimiser le fonctionnement des institutions et, in fine, la prise en charge de nos patient·e·s.
Venant du milieu académique (CHUV), je me suis attelé, en prenant mes fonctions à l’hôpital de Morges (EHC), à analyser la situation des hôpitaux dits périphériques dans le canton de Vaud. Malgré le fait que ceux-ci dépassent ensemble le nombre de lits et d’hospitalisations par rapport à l’hôpital universitaire, le constat est sans appel : chacun a sa propre vision et une relative méconnaissance des activités des autres, en tous les cas au niveau médical, ce qui mène le plus souvent à une concurrence plutôt qu’à des rapprochements. Seule exception : les liens entre chaque hôpital régional et le CHUV qui, de facto, ne sont souvent pas sur le même pied d’égalité.
Cette idée d’échanger entre les différents membres FHV a mûri et a abouti à l’organisation d’un premier symposium à Morges en 2023. Cette rencontre a été l’occasion de démontrer la volonté des différentes parties prenantes de passer d’un modèle plutôt protectionniste à une vision partenariale. Les présentations des différent·e·s intervenant·e·s venant des cinq centres de soins aigus de la FHV ont permis de mieux connaître leurs spécificités et d’envisager certains rapprochements.
La deuxième édition, qui aura lieu à l’automne 2024 à l’hôpital d’Yverdon, va permettre de présenter les projets émergents dans le cadre de cette collaboration entre hôpitaux. Il s’agit aussi d’inviter les élu·e·s politiques et de les sensibiliser à cette thématique, ce type de partenariats s’inscrivant pleinement dans la mission de santé publique du Canton.
Préserver des hôpitaux régionaux performants
La nouvelle planification hospitalière vaudoise en vigueur depuis le 1er janvier 2024 a représenté un coup d’accélérateur dans le rapprochement entre établissements de la FHV qui peuvent désormais envisager des partenariats dans un climat apaisé. Mais ce n’est de loin pas le seul incitatif. Il s’agit avant tout de garder les patient·e·s dans leur région, pour leur propre bénéfice et pour celui de la structure qui va augmenter son attractivité, que ce soit au niveau de ses prestations médicales mais aussi de la formation des médecins. En outre, la crise du Covid-19 a mis en lumière l’importance de conserver des hôpitaux régionaux forts et agiles, capables de désengorger l’hôpital universitaire et de répondre efficacement aux besoins de leur bassin de population.
La collaboration inter-hospitalière est absolument fondamentale car elle permet en premier lieu de partager les compétences et les bonnes pratiques. Elle nécessite à cette fin une certaine mobilité du corps médical. Dans mon propre cas, je suis médecin chef de la chirurgie vasculaire de l’EHC et médecin agréé dans différents hôpitaux de la FHV au même titre que mes collègues, ce qui nous permet d’intervenir régulièrement au sein de ces structures. Cela est rendu possible par des conventions bilatérales entre membres de la FHV. C’est une nouvelle culture qui se met progressivement en place au sein des hôpitaux régionaux. Les directrices et directeurs de ces institutions ont bien compris que ces collaborations favorisent le rayonnement de leur institution tout en augmentant la qualité de prise en charge de leurs patient·e·s qui bénéficient de soins performants au plus proche de leur domicile.
Travailler en équipe pour passer en ligue supérieure
À noter que la collaboration inter-hospitalière touche bien d’autres domaines cruciaux pour le développement de soins de qualité au bénéfice des populations locales. Cela peut concerner autant le partage ou la répartition de ressources, d’équipements et de fournitures médicales entre établissements que le développement de programmes de formation communs ou la mutualisation de certaines structures comme les laboratoires médicaux. Au final, le fait de travailler en réseau permet de gagner en performance, tout en contenant les coûts. Concernant la recherche, il est consternant de noter qu’aujourd’hui, la promotion académique n’est pas soutenue hors du CHUV. C’est pourquoi une dizaine de chercheur·euse·s de l’hôpital de Morges ont écrit une lettre d’intention pour créer une unité de recherche clinique dans cet établissement afin que les projets puissent s’appuyer également sur la multitude de données cliniques fournies par les hôpitaux régionaux. Une nécessité pour passer en ligue supérieure.
Pour y arriver, il est nécessaire que tous les hôpitaux et pôles de santé membres de la FHV jouent avec le même esprit d’équipe. Dans ce cadre, la fédération devient le socle de la défense et de la promotion d’une activité régionale médicale et pas seulement au niveau administratif ou tarifaire, en traitant tous ses membres sur un pied d’égalité et en favorisant de vraies relations bilatérales. L’objectif est de partager et non de phagocyter. Une stratégie innovante et prometteuse avec le soutien de toutes et tous.
Interview
Regards croisés entre
Etienne Caloz et Mikael de Rham
L’ère des alliances n’est qu’à ses prémices
Directeur général
Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL)

Directeur général
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC)

Fin 2023, le Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) et l’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) ont signé une convention visant à établir une collaboration stratégique en neurologie et en cardiologie. Les patient·e·s bénéficient ainsi d’une prise en charge optimale tout en restant dans leur région, que cela soit dans la Stroke Unit de l’hôpital de Nyon ou dans le Centre de cardiologie interventionnelle de l’hôpital de Morges. Les deux directeurs respectifs – Etienne Caloz (EC) et Mikael de Rham (MR) – vont-ils continuer sur cette lancée ?
De concurrents il y a quelques années à partenaires. Qu’est-ce qui a changé ?
Etienne Caloz : Même s’il y a eu quelques domaines concurrents par le passé au sein de la FHV, la nouvelle génération de directrices et directeurs à la tête des institutions membres et le renouvellement des conseils d’administration ont renforcé l’esprit partenarial, car tout le monde a compris que l’on a plus à gagner en collaborant. Les discussions se sont également élargies aux partenaires hors hôpitaux comme les CMS. La tendance est aux réseaux intégrés que je préfère appeler « intégrants ».
Mikael de Rham : La bonne nouvelle, c’est qu’il ne peut pas y avoir de compétition entre les hôpitaux de la FHV car chaque établissement a la grande chance de disposer de son propre bassin de population. La concurrence se situe plutôt vis-à-vis du secteur privé. Malgré tout, on a voulu nous faire croire à un moment donné qu’il y avait un hôpital de trop dans l’ouest du canton. Or chacun a un bassin de population de taille suffisante et en forte croissance qui justifie sa raison d’être et son développement avec des plateaux techniques propres. Cela a d’ailleurs été approuvé par l’État, notamment en termes d’investissements. Au-delà de ce même ADN qui nous caractérise, ces alliances reposent avant tout sur des femmes et des hommes qui ont envie de collaborer et qui considèrent que cela fait sens.
Quelle a été la motivation principale pour signer une convention de partenariat fin 2023 ?
MR : L’objectif est de gagner en efficience grâce à des partenariats intelligents. N’oublions pas que les hospitalisations au sein de la FHV représentent près des deux tiers de toutes les hospitalisations du canton. Il est important de garder une stratégie régionale et de référer au CHUV les patient·e·s complexes qui requièrent un plateau technique universitaire. Ainsi, l’hôpital de Nyon excelle dans la neurologie. L’hôpital de Morges va continuer à faire de la neurologie de base, mais nous comptons sur notre partenaire régional pour la neurologie plus spécialisée (Stroke Unit). À l’inverse, l’hôpital de Morges bénéficie d’un Centre de cardiologie interventionnelle qui va pouvoir profiter à l’hôpital de Nyon.
EC : Nos hôpitaux sont suroccupés, nous manquons de lits pour la réadaptation et en EMS. La situation n’est pas bien meilleure en soins aigus. Nous ne cherchons pas à gagner des patient·e·s, mais à mieux les prendre en charge. C’est effectivement un changement de paradigme car, comme déjà dit, nous n’avons plus à justifier notre existence. Mais les hôpitaux périphériques ne peuvent pas tous tout faire. Historiquement, certaines disciplines se sont plus développées dans l’un ou l’autre des établissements. Il s’agit à présent de mettre ces compétences en commun sur la base de partenariats au lieu de systématiquement envoyer les malades vers l’hôpital universitaire, souvent saturé et parfois éloigné du domicile.
Était-ce la première collaboration de ce type entre le GHOL et l’EHC ?
MR : Non, il y avait déjà des partenariats, par exemple en chirurgie vasculaire et en chirurgie bariatrique. D’autres sont en cours de mise en œuvre comme en chirurgie du rachis. On peut aussi citer la Pharmacie Interhospitalière de la Côte qui a été créée en commun il y a près de 30 ans.
EC : Nous avons également des partenariats avec d’autres hôpitaux membres de la FHV.
La nouvelle planification hospitalière vaudoise a-t-elle joué un rôle dans ce rapprochement ?
MR: Elle a agi comme un accélérateur. Dans ce cadre réglementaire, on se rend vite compte qu’on est plus performants en mettant nos compétences en commun.
EC : Son défaut est qu’elle fige les domaines. Il ne faudrait pas que cette mutualisation des compétences nous fasse perdre en agilité.
Quels sont les avantages attendus pour vos hôpitaux respectifs, et plus important encore, pour les patient·e·s de la région ?
EC : Grâce à ce partenariat, nous gardons des soins de haute qualité au sein de la région, ce qui représente un bénéfice primordial aussi pour les patient·e·s qui n’auront pas à s’éloigner trop de leur domicile. Au lieu de saturer le CHUV, l’objectif est de les adresser en priorité à notre voisin.
MR : Et nous gagnons sans conteste en attractivité pour les médecins. Dans ces deux filières, nous avons du personnel mobile qui apprécie cette façon de travailler en saine collaboration tout en visant l’excellence. Ainsi, si la ou le spécialiste d’un établissement est limité·e sur son plateau technique, l’hôpital voisin peut lui ouvrir le sien. Les conventions mises sur pied jusqu’à aujourd’hui fonctionnent très bien. Le défi principal est de pérenniser ces alliances au-delà des personnes actuellement en place.
EC : L’objectif d’un·e spécialiste reste que sa ou son patient·e soit pris·e en charge par des personnes compétentes et le plus rapidement possible, sans se soucier de l’endroit. Du côté du GHOL, ce que nous devons améliorer à présent, c’est la collaboration avec les médecins installé·e·s, d’autant plus que 60% des assuré·e·s possèdent actuellement un modèle « médecine de famille ».
Ce type de partenariat permet-il de garder une certaine concurrence vis-à-vis de l’hôpital universitaire, notamment en termes de médecine hautement spécialisée, de formation et de recherche ?
MR : Pour rester attractif, il faut que l’hôpital possède un éventail suffisamment large de spécialités car elles se potentialisent les unes avec les autres. Nous devons en plus capitaliser sur quelques secteurs de pointe qui vont tirer les pratiques de soins vers le haut.
EC : La médecine hautement spécialisée reste à l’hôpital universitaire. Mais ce type de partenariat permet d’atteindre la masse critique en termes de patientèle et ainsi d’attirer les meilleur·e·s spécialistes dans leur domaine. Le CHUV a également un intérêt à collaborer avec les hôpitaux régionaux car il est en incapacité de tout absorber.
Concernant la recherche, nos médecins contribuent aux protocoles de tests et nos cohortes de patient·e·s viennent régulièrement nourrir les bases de données dans le cadre des études menées à l’hôpital universitaire.
Cela permet-il aussi d’être plus fort face au secteur privé ?
EC : La planification hospitalière nous a mis à l’abri de cette concurrence dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins. Nous privilégions les relations de collaboration avec ces acteurs, notamment dans les disciplines que nous n’avons pas, comme la radio-oncologie ou la médecine nucléaire, et à l’inverse nous offrons des formations à leurs médecins-assistant·e·s.
MR : Les vingt dernières années, nous avons assisté à une sorte de course à l’armement des hôpitaux. Il fallait se munir d’équipements lourds et des dernières technologies pour démontrer sa performance. À présent, nous sommes entrés dans l’ère des alliances. Dans ce contexte, il faudra quand même choisir son camp. Alors que nos hôpitaux sont au service de toutes et tous les patient·e·s, le secteur privé, détenu par des actionnaires, va naturellement choisir les domaines les plus rentables.
Des prochaines collaborations sont-elles prévues, notamment pour d’autres filières ou avec d’autres acteurs de la santé régionaux ?
EC : il y a un fort potentiel de collaboration dans les fonctions de support comme la qualité et la sécurité des patient·e·s, la médecine du personnel ou encore le DPI (ndlr: Dossier Patient Informatisé). L’hôpital de Nyon va prochainement mettre sur pied une consultation en neurochirurgie assurée par les spécialistes de l’EHC.
MR : En lien avec sa position géographique, l’hôpital de Morges travaille aussi avec l’hôpital d’Yverdon sur certaines filières comme la cardiologie, la vasculaire, la bariatrique et l’angiologie. Cette ère des alliances n’en est qu’à ses débuts et la conjoncture actuelle y est favorable.
Collaboration : Fondation de Nant et HRC
La psychiatrie comme partenaire à part entière de l’hôpital
Directeur
Fondation de Nant




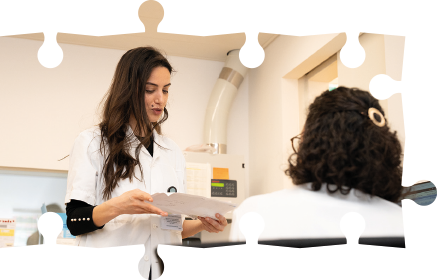
SPAUL, vous connaissez ? Rattaché à la Fondation de Nant, ce dispositif prend en charge les soins psychiatriques au sein de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) à trois niveaux : l’accueil, les urgences et la liaison. Il représente un exemple de collaboration inter-hospitalière au bénéfice de toutes et tous les patient·e·s de l’Est vaudois atteint·e·s dans leur santé mentale. Il est complété par l’Équipe Mobile d’Intervention Rapide – EMIR.
La collaboration entre la Fondation de Nant et l’HRC a débuté en 2010. À cette époque, des consultant·e·s de la Fondation de Nant bénéficiaient de locaux sur le site du Samaritain à Vevey et exerçaient principalement une activité de liaison sur demande de l’hôpital. Elles et ils assuraient également la permanence téléphonique.
Le virage ambulatoire pris par le canton de Vaud et l’organisation du dispositif de réponse à l’urgence ont accéléré la mise en place d’une réponse permanente, notamment en ce qui concerne les urgences psychiatriques. Outre des objectifs d’allègement du système hospitalier – pas forcément atteints car plus les portes de l’ambulatoire sont ouvertes, plus l’hospitalier est mis sous tension – il s’agit de promouvoir la déstigmatisation des cas relevant de la psychiatrie et de participer à une vision intégrée de la médecine.
Trois domaines et une équipe mobile
Le SPAUL, ce sont les Soins Psychiatriques Accueil, Urgence, Liaison. Au niveau de l’accueil, le SPAUL dispose d’un numéro gratuit d’accueil 24h/24 7j/7 (0800 779 779) pour centraliser les demandes et représente à ce titre une des portes d’entrée majeures sur le site de Rennaz. Preuve de son utilité : les appels ont augmenté de 25% entre 2022 et 2023.
Concernant les urgences psychiatriques, elles sont assurées par le personnel de la Fondation de Nant dans ses propres locaux situés à proximité immédiate des urgences somatiques du Centre hospitalier de Rennaz depuis 2019, ce qui favorise la collaboration entre les deux. L’infirmière du tri va diriger la personne qui arrive aux urgences soit en somatique soit en psychiatrique, ou encore vers une prise en soins conjointe. Il s’agit d’un modèle novateur qui se répand progressivement en Suisse. Les urgences psychiatriques fonctionnent 24h/24 et 7j/7 et accueillent aussi bien la population du Chablais valaisan que celle de l’Est vaudois. Une garde médicale sur site a également été introduite alors qu’il fallait avant se déplacer jusqu’à la Fondation de Nant.
Quant à la liaison, depuis la mise en place de ce dispositif, du personnel médico-soignant se déplace dans les services du Centre hospitalier de Rennaz sur demande. Il peut s’agir d’un soutien psychique spécifique apporté à une personne en hospitalier ou en ambulatoire, mais aussi d’une aide aux équipes soignantes en cas de fatigue chronique ou pour faire face à une situation difficile. Plus généralement, cela permet d’amener un regard spécialisé autour de la psychiatrie pour les personnes hospitalisées. Ainsi, il existe une consultation ambulatoire de psychiatrie de liaison en périnatalité et en oncologie qui permet un suivi à la sortie de l’hôpital. En 2023, on a dénombré 3600 consultations de liaison.
En complément de ce dispositif, l’EMIR consiste en une équipe infirmière mobile qui intervient au chevet de la personne malade dans les deux heures. Créée en 2019, l’EMIR a été pilotée par l’HRC jusqu’en juillet 2023 avant d’être intégrée – en tant que dispositif de réponse à l’urgence – au Réseau Santé Haut-Léman (RSHL). Les objectifs sont multiples : éviter un transport inutile vers les urgences ou une hospitalisation inappropriée, permettre la mise en place d’un réseau de soins et refaire le lien avec l’entourage.
Le SPAUL et l’EMIR font partie du service de la psychiatrie adulte rattaché à la Fondation de Nant. Le SPAUL est dès lors l’interlocuteur unique de l’HRC pour les activités psychiatriques d’accueil, d’urgence et de liaison. Au niveau fonctionnel, l’HRC a intégré la psychiatrie parmi ses 13 autres services cliniques.
En ce qui concerne les enfants et adolescent·e·s, la Fondation de Nant possède des bureaux à l’Espace Santé Rennaz, proche du Centre hospitalier de Rennaz. Elle y organise des consultations de psychiatrie et psychothérapie pour enfants, adolescent·e·s et personnes âgées, des consultations en urgence et de crise, ainsi que des consultations de liaison pour les patient·e·s de l’Hôpital Riviera Chablais. Pour les urgences pédiatriques, c’est le service pédiatrique de l’HRC qui intervient en première ligne avant que le ou la patient·e puisse être vu·e par les pédopsychiatres de la Fondation de Nant.
Des synergies bénéfiques pour toutes et tous
Cette collaboration fonctionnelle entre somaticien·ne·s et psychiatres, que ce soit aux urgences ou dans le cadre de l’EMIR, a évolué de manière très positive entre 2019 et aujourd’hui. Elle améliore sans conteste la prise en soins des patient·e·s ayant besoin de soins psychiatriques. Cette convention entre les deux institutions favorise les réunions multidisciplinaires, ainsi que les opportunités de collaboration et de réflexion entre services, chacun·e devant aussi apprendre à tenir compte de rythmes de travail différents. Du reste, depuis fin 2023, un groupe de travail de l’HRC travaille avec la Fondation de Nant pour repenser les locaux et améliorer les flux des urgences.
Ces ponts entre somatique et psychiatrie sont aussi facilités au niveau de la formation. L’Institut de formation du Haut-Léman (IFHL) propose aux somaticien·ne·s des cours sur la gestion de la violence. Autre exemple : un CAS en management a été mis sur pied par la Fondation de Nant, l’HRC, ASANTE SANA, le Réseau Santé Haut-Léman et l’Ecole de la Santé de la Source. La Fondation de Nant et l’HRC collaborent dans d’autres domaines comme le débriefing aux soins intensifs qui sera prochainement étendu à tout le personnel de l’HRC.
Cette collaboration inter-hospitalière implique aussi un certain nombre de défis tels que l’accès au dossier patient Soarian ou à celui du SPAUL, l’occupation des locaux (car tout le monde manque de place) ou la facturation entre les deux institutions. Toutefois, l’excellente entente entre directions générales, directions de clinique et chefferies de clinique permet de les relever dans les meilleures conditions.
Hôpital de référence et pôle santé
Vers une vraie complémentarité ?
Directeur
Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ)

Par leur proximité géographique, le Réseau Santé Balcon du Jura (RSBJ) et les Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) ont régulièrement été amenés à collaborer en misant sur des missions complémentaires. Plusieurs conventions ont été mises sur pied avec les eHnv, notamment au niveau des laboratoires, de la stérilisation et du codage de la facturation. Avec l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB), les deux entités sont aussi à l’origine de la fondation de la Pharmacie des Hôpitaux du Nord vaudois et de la Broye, désormais indépendante juridiquement.
Collaborer au lieu de recentrer
Dans le cadre de la planification hospitalière de 2017 dans le canton de Vaud, un accord de collaboration a été produit par les trois pôles santé – le Réseau Santé Balcon du Jura, le Pôle Santé Vallée de Joux et le Pôle Santé du Pays d’Enhaut – avec leur hôpital de référence respectif pour définir les grands principes d’un travail en commun. De la convention cadre a découlé des conventions de collaborations spécifiques, notamment pour les soins intensifs et l’accès aux urgences. Ainsi, lorsqu’une prise en charge intensive est requise, la personne qui arrive au RSBJ est directement redirigée sur Yverdon. Ce partenariat entre les deux directions médicales fonctionne parfaitement.
Cette planification hospitalière aurait dû nous donner l’opportunité de réfléchir aux synergies envisageables entre hôpital de référence et pôle de santé dans le but d’améliorer la prise en charge de la population dans un bassin donné, dans ce cas le nord de la Broye. Cependant, les délais impartis pour sa mise en œuvre ne nous ont pas encore permis d’aller au bout de cette démarche, malgré tout le travail d’anticipation que nous avons accompli en lien avec ce processus de collaboration. Subissant les logiques des économistes de la santé, nous assistons plutôt à un recentrage des institutions sur elles-mêmes et sur les travaux qu’elles doivent réaliser pour justifier leurs activités. De leur côté, les eHnv font actuellement face à de grands défis pour dessiner leurs futurs contours avec la fermeture à terme de l’hôpital de St-Loup et du centre de traitement et de réadaptation de Chamblon, et un recentrage sur Yverdon (soins aigus) et Orbe (réadaptation et soins palliatifs). Ce contexte ne favorise pas l’esprit de partenariat.
Reconnaître l’utilité des petites structures
Cela pose la question de la survie des dispositifs dans les régions excentrées et dans notre cas l’hôpital de Sainte-Croix. Or celui-ci se situe dans un système de soins intégrés aux côtés de la médecine de premier recours, des dispositifs médicaux-sociaux et à l’avenir de l’aide et des soins à domicile. Ce maillage répond efficacement aux besoins sanitaires de la population. Il y a 10 ans, nous faisions face à un plaidoyer pour la fermeture des lits hospitaliers alors qu’avec le vieillissement de la population, la limitation de ce que peuvent offrir les soins à domicile et un manque de place dans les structures de réadaptation, les hôpitaux se retrouvent régulièrement débordés. Sans parler du problème de pénurie du personnel médico-soignant, exacerbé dans les régions périphériques. La crise du Covid-19 a définitivement démontré la nécessité de conserver les structures hospitalières régionales.
De plus, les pôles santé peuvent aussi amener une expertise qui bénéficie à l’hôpital de référence. Par exemple, le RSBJ a développé depuis 2017 une prise en charge rééducative des personnes âgées pour maîtriser le déclin fonctionnel. Ce dispositif fait interagir les médecins de premier recours, les hôpitaux, les institutions médico-sociales et les soins à domicile, en collaboration avec le Réseau Santé Nord-Broye. Il intègre aussi une consultation précoce de détection de la fragilité somatique chez la personne âgée afin de mettre en place des mesures favorisant son maintien à domicile. Il s’agit d’une démarche que l’on pourrait présenter à nos partenaires, même au-delà des eHnv, et qui s’inscrit parfaitement dans les orientations voulues par la Confédération pour développer les soins intégrés.
Une question de gouvernance à résoudre
La planification hospitalière pose une vraie question de gouvernance entre l’hôpital de référence et son pôle de santé, sachant que les deux institutions sont interdépendantes mais restent autonomes. Il s’agirait de pouvoir déterminer ensemble – c’est-à-dire l’hôpital de référence, le pôle santé mais aussi la Direction générale de la santé – les liens et les rôles de chacun, tout en évaluant les moyens que l’on octroie à l’hôpital de référence pour qu’il soit capable de soutenir son pôle. Après l’appel d’offres lancé par la planification hospitalière et la communication sur les activités attribuées à chaque institution, il manque une phase de transition qui devrait permettre de clarifier ces liens. Il est à mes yeux impératif de continuer à réfléchir ensemble pour chercher les opportunités et les synergies au profit de la population et des institutions régionales.
Digitaliser le processus de gestion des mesures limitatives de liberté :
un défi qu’il fallait relever à trois
Responsable du Système d’information
Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB)

Chef de l’État-major
Fondation de Nant

L’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) s’est allié à la Fondation de Nant pour digitaliser, avec les équipes de la FHVi, le processus complexe de la gestion des mesures limitatives de liberté (MLL) en milieu hospitalier. Cette collaboration a permis de développer une nouvelle fonctionnalité dans le dossier patient informatisé qui bénéficiera à l’ensemble des établissements membres de la FHVi.
Les MLL sont des mesures appliquées à l’insu ou contre la volonté d’un·e patient·e lors d’un séjour en établissement hospitalier. Elles peuvent prendre des formes diverses comme par exemple l’isolement ou l’immobilisation de la personne, la pose de barrières autour de son lit ou l’administration d’un médicament. Par nature contraignantes, elles s’inscrivent dans un cadre légal strict. Une MLL est une forme de « dernier recours », qui ne peut être prescrite que par un·e médecin lorsqu’un·e patient·e met gravement sa santé ou celle d’autrui en danger. De sa prescription à sa levée, le processus médical est complexe, exigeant à la fois une documentation rigoureuse, une surveillance accrue de la part du personnel soignant et une réévaluation régulière de la mesure. Les hôpitaux membres de la FHVi gèrent encore largement ce processus sur papier, mais en 2023, un projet visant à l’informatiser a abouti grâce aux efforts de l’Hôpital Intercantonal de la Broye, de la Fondation de Nant et des équipes de la FHVi.
L’expertise et l’engagement de deux établissements au service de tous les autres
Lorsque la Conférence des directeurs et directrices des soins de la FHV a décidé de faire de la digitalisation de ce processus un projet, la Fondation de Nant en a naturellement pris le leadership. Cette institution qui organise l’ensemble des soins psychiatriques publics de l’Est vaudois est, parmi les membres de la FHVi, celle qui est le plus souvent confrontée à des situations où la prescription d’une MLL s’impose. Les hôpitaux psychiatriques suisses appliquent en effet une centaine de ces mesures en moyenne chaque jour. Marcos della Paolera, Chef de l’État-major de la Fondation de Nant, explique : « Au vu de notre expérience particulière en matière de mesures privatives de liberté, la gouvernance des soins nous a demandé d’apporter notre expertise au projet et de nous assurer que la solution développée dans Soarian – le dossier patient informatisé – réponde bien à nos exigences, notamment en termes de traçabilité ». Du côté de l’HIB, Yvonne Zumbrunnen, ancienne Infirmière Cheffe d’Unité de Soins et désormais Responsable du Système d’information, s’est impliquée pour veiller à ce que la nouvelle fonctionnalité corresponde également aux besoins des hôpitaux de soins somatiques aigus. « Nous avons travaillé avec la Fondation de Nant et la FHVi pour identifier les étapes communes des différents processus métier qui interviennent en cas de MLL, sur la base du processus papier et de deux formulaires Soarian déjà existants, afin de concevoir les bons d’ordre et les formulaires à intégrer dans la solution. Des groupes de travail comprenant des chef·fes de projet FHVi et des référent·e·s cliniques des deux institutions ont été organisés et les options prises ont été validées par des médecins ».
La collaboration entre l’HIB et la Fondation de Nant avait donc l’objectif de prendre en compte toutes les situations possibles pour développer une solution optimale, pouvant être utilisée via Soarian par tous les établissements membres de la FHVi dans les unités où la documentation soignante est réalisée par le biais des interventions de soins.
De la théorie à la pratique
Chargées de concevoir, configurer et créer le contenu de la fonctionnalité dans Soarian, les équipes de la FHVi ont digitalisé un processus complexe qui se déroule en plusieurs étapes.
Si une mesure limitative de liberté s’avère nécessaire pour un·e patient·e, le·la médecin commence par sélectionner la mesure appropriée dans la liste des MLL et complète les différents champs du bon d’ordre, entre autres la fréquence et la récurrence de la surveillance infirmière et de la réévaluation médicale. Une fois le bon d’ordre signé, le système déclenche l’ordre (intervention de soins) de la pose de la MLL que l’infirmier·ère valide depuis le module SOINS (interface de documentation des interventions des soins). Cette action déclenche à son tour la création de l’intervention de surveillance infirmière et l’ordre de réévaluation médicale à la fréquence définie dans le bon d’ordre médical initial. À chaque étape (pose, surveillance, réévaluation), un formulaire de documentation clinique est rempli. En raison de ces cascades techniques, chaque mesure limitative est prescrite individuellement.
Le processus de prescription est complété par :
- Une icône d’identification au niveau de l’écran d’accueil pour toute MLL active ;
Un onglet du résumé clinique qui restitue les différentes documentations (formulaires médicaux et soignants) ;
Un formulaire imprimé destiné au ou à la patient·e et à ses proches expliquant la démarche d’une MLL ainsi que les mesures appliquées.
Lors de la levée de la mesure limitative, le·la médecin prescrit l’ordre de retrait que l’infirmier·ère valide. Le système stoppe les interventions associées à la MLL et lorsque l’ensemble des mesures ont été validées comme retirées, l’icône d’identification disparaît.
Un déploiement plus large de la fonctionnalité prévu en 2024
« Au vu de la complexité de ce processus et du nombre d’intervenant·e·s impliqué dans la gestion des MLL en milieu hospitalier, l’expertise et l’engagement de deux établissements dans le projet n’était pas de trop », commente Alexandre Briguet, Team leader Dossier patient informatisé à la FHVi. La solution a été déployée dans les deux institutions pilotes et le sera au sein des autres établissements membres de la FHVi en 2024. Pour Yvonne Zumbrunnen, le projet est un succès : « La collaboration avec la Fondation de Nant, surtout en amont du développement de la fonctionnalité, a été extrêmement enrichissante et l’accompagnement de la FHVi très pointu. Le résultat est un processus digitalisé qui garantit la traçabilité des interventions du personnel soignant en cas de MLL, en adéquation avec les exigences légales actuelles. L’utilisation n’étant pas quotidienne et en raison du tournus médical, un rappel périodique reste indiqué en milieu somatique ».
